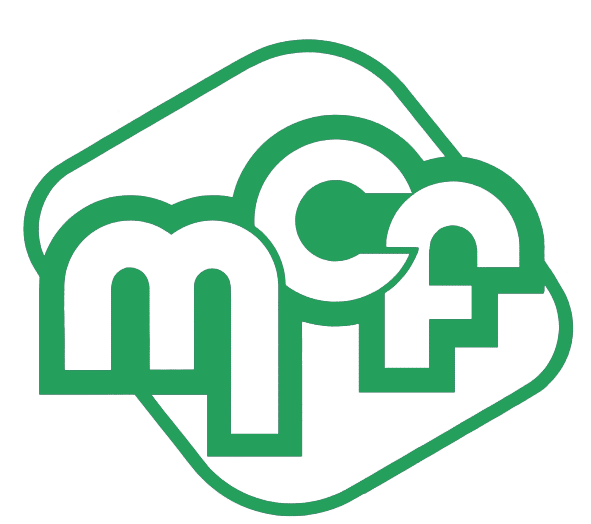Accompagner ses proches dans la maladie ou la perte d’autonomie : par où commencer ?

Apprendre que l’un de ses proches perd en autonomie ou est atteint d’une maladie grave bouleverse profondément le quotidien. Mais quelles sont les démarches à entamer ? Vers qui se tourner ? Comment concilier vie personnelle et rôle d’aidant ? Accompagner un proche dans la maladie ou la perte d’autonomie demande du temps, de l’organisation et un solide réseau de soutien. Heureusement, il existe des ressources pour ne pas avancer seul. Cet article vous guide pas à pas pour comprendre par où commencer, identifier les bonnes personnes à contacter et construire un accompagnement adapté.
Accompagner un proche en perte d’autonomie : comment s’y retrouver ?
Lorsqu’un proche perd en autonomie, que ce soit en raison de l’âge, d’une maladie neurodégénérative ou d’un accident, la question de l’accompagnement devient centrale. Mais par où commencer quand on n’est ni professionnel de santé, ni préparé à endosser ce rôle ?
Avant toute chose, il est important d’évaluer les besoins concrets de la personne concernée : a-t-elle besoin d’une aide pour se laver, manger, se déplacer ? Présente-t-elle des troubles cognitifs ? Est-elle en sécurité chez elle ? Cette première étape est essentielle pour poser un diagnostic de la situation. Une évaluation peut être demandée auprès d’un médecin traitant, du Conseil départemental ou d’un service de soins à domicile. Elle permettra de déterminer les aides nécessaires et les aménagements à prévoir. Cela vous aidera aussi à anticiper les évolutions possibles de son état de santé et à planifier les premières étapes en tant qu’aidant familial.
Newsletter
Inscrivez vous à la newsletter
Se faire accompagner pour ne pas s’épuiser
Devenir aidant, c’est plonger dans un quotidien fait de multiples responsabilités : soutien physique, moral, logistique et administratif. Pour éviter l’isolement et l’épuisement, il est crucial de demander de l’aide dès le départ. Une assistante sociale peut être un véritable pilier pour identifier les ressources locales, débloquer les aides financières comme l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) ou la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) ou organiser un relais avec des professionnels.
Il existe aussi de nombreux réseaux d’aidants, plateformes d’écoute, groupes de parole et associations comme France Alzheimer, l’Association Française des Aidants ou les Maison des Aidants. Ils permettent de bénéficier de conseils pratiques, d’un soutien psychologique et d’échanger avec d’autres personnes confrontées à des situations similaires.
Devis et adhésion en ligne
Votre devis personnalisé santé et prévoyance en moins de 3 minutes
Organiser le quotidien et anticiper les évolutions
Une fois les besoins identifiés et un minimum d’accompagnement mis en place, vient le temps de l’organisation. Être aidant demande une gestion rigoureuse et une coordination entre plusieurs intervenants : infirmiers, auxiliaires de vie, kinésithérapeutes, médecins, etc. Il est utile de tenir à jour un carnet ou un fichier partagé contenant les informations médicales essentielles, les coordonnées des professionnels de santé, les rendez-vous et les traitements.
L’adaptation du logement (barres d’appui, lit médicalisé, monte-escalier) est aussi une étape clé pour garantir la sécurité du proche. Il faut également penser à long terme : que se passera-t-il si l’état de santé du proche se dégrade ? Peut-on envisager une entrée en EHPAD ou une solution d’accueil temporaire ? Ces décisions sont souvent difficiles à prendre mais il est préférable de les anticiper pour éviter de devoir les gérer dans l’urgence. Accompagner un proche, c’est aussi accepter que les besoins évoluent, et s’autoriser à adapter les solutions au fil du temps.
Source : Service-Public.fr
Partager