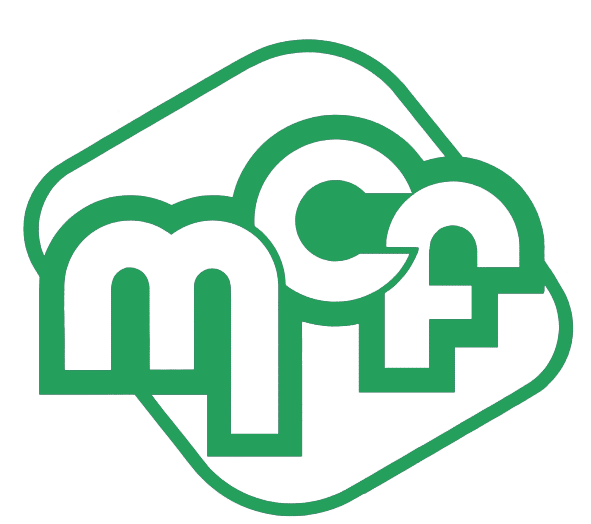Don du sang : ce qui a changé en 2025

Les modalités pour donner son sang ont évolué en 2025, avec beaucoup d’assouplissements pour permettre à plus de personnes de se rendre en collecte régulièrement. Zoom sur les nouveaux critères d’éligibilité.
Délai réduit de 4 à 2 mois après un tatouage ou un piercing
Les personnes qui ont récemment fait une modification corporelle esthétique comme un tatouage, du maquillage permanent ou un piercing peuvent donner leur sang plus rapidement ! En effet, s’ils ne sont pas pratiqués dans des conditions sanitaires irréprochables (matériel stérile ou à usage unique, respect des consignes de cicatrisation…), les tatouages et piercings peuvent exposer à des maladies virales comme l’hépatite C. C’est pourquoi il était demandé de respecter une période de quatre mois entre un acte de modification corporelle et un don du sang. Mais, depuis le 1er septembre 2025, de nouveaux tests de dépistage permettent de repérer plus rapidement la présence de ces virus et ainsi de réduire le délai pour donner son sang.
Newsletter
Inscrivez vous à la newsletter
Délai réduit à 2 mois après une intervention utilisant des aiguilles : acupuncture, mésothérapie, sclérose de varices
Les soins impliquant l’utilisation d’aiguilles, même de façon superficielle, exposent à un risque bactériologique et infectieux s’ils ne sont pas pratiqués dans des conditions médicales encadrées. Le délai pour donner son sang après de tels soins était de quatre mois, mais il a été réduit à deux, en raison de l’arrivée de tests de dépistage plus rapides et fiables. En effet, tout acte qui implique la perforation de la peau avec ou sans injection d’un produit demande de s’assurer de l’absence de complication, réactions ou infection silencieuse, c’est pourquoi un délai de deux mois avant un don du sang est demandé.
Devis et adhésion en ligne
Votre devis personnalisé santé et prévoyance en moins de 3 minutes
Accès facilité au don pour les personnes souffrant d’hémochromatose
L’hémochromatose est une maladie génétique qui se manifeste par une accumulation excessive de fer dans le sang. Des saignées doivent donc être pratiquées régulièrement pour réduire le stock de fer. Jusqu’à présent, les personnes porteuses de cette maladie devaient justifier de cinq saignées à l’hôpital avant d’être éligibles au don du sang. Elles peuvent maintenant se rendre directement en collecte, sans avoir fait de saignées au préalable. Le type de don privilégié est donc celui du don-saignée : pratiqué sur ordonnance, il permet d’obtenir des produits sanguins ayant les mêmes qualités et présentant la même sécurité que les dons de sang habituels, tout en étant bénéfique pour la santé des donneurs.
Substituts osseux en implantologie dentaire : plus d’exclusion permanente
Par le passé, l’utilisation de substituts osseux lors d’une pose d’implant dentaire excluait définitivement au don du sang. Bonne nouvelle : les matériaux utilisés ont évolué et sont aujourd’hui traités pour éliminer ou neutraliser tous les agents pathogènes avant pose de l’implant. On parle de viro-inactivation pour désigner ces processus. Les personnes porteuses d’implants dentaires avec substituts osseux peuvent donc donner leur sang sans contre-indication ! Il est toutefois recommandé de demander à son dentiste la nature exacte du traitement avant un don.
Deux mois d’attente après une endoscopie souple
La coloscopie ou la fibroscopie sont des examens internes réalisés à l’aide de dispositifs souples, dans des zones très sensibles aux organismes pathogènes (intestins, oesophage, estomac…). Ils peuvent entraîner, dans de rares cas, des microtraumatismes et le passage de bactéries dans le sang : il est donc nécessaire de surveiller son état général après une telle intervention et de respecter un délai avant de donner son sang. Celui-ci a été abaissé à deux mois pour permettre à plus de personnes de continuer à donner leur sang.
Pourquoi de telles contre-indications au don du sang ?
Le don du sang est un acte volontaire et citoyen, mais aussi fortement encadré par une législation et des règles qui évoluent au fil des avancées scientifiques. Il existe différentes contre-indications au don, qui permettent d’une part de protéger le receveur en garantissant un produit sanguin de qualité, et d’autre part de protéger le donneur en évitant des complications suite au don. De manière générale, il faut être âgé de 18 à 70 ans, être en bonne santé et peser au moins 50 kilos pour donner son sang en toute sécurité. L’éligibilité au don est vérifiée en collecte à l’aide de plusieurs critères :
- Critères liés à l’état de santé ou aux antécédents : examen récent, infection, prise de certains médicaments, transfusion, greffe…
- Critères personnels : tatouage ou piercing récent, antécédents de consommation de drogues ou de substances actives par voie intraveineuse ou intramusculaire, voyages dans des zones à risques…
- Critères liés à des pratiques sexuelles : partenaires différents sur une période de quatre mois, rapports sexuels avec personnes infectées…
Que faire si je ne peux pas donner mon sang ?
Vous voulez donner votre sang ? Vérifiez d’abord votre éligibilité sur le questionnaire de l’EFS. Si vous présentez des contre-indications, sachez qu’elles sont généralement limitées dans le temps. Un peu de patience et vous pourrez vous rendre en collecte sans risque.
Si vous présentez une contre-indication permanente au don, par exemple si vous avez déjà eu une transfusion ou une greffe, il existe d’autres moyens de s’engager pour le don du sang :
- Encouragez vos proches à se rendre régulièrement en collecte, aidez-les à lever les derniers freins !
- Engagez-vous en tant que bénévole à l’EFS pour aider aux collectes et aux missions de sensibilisation
- Parlez-en sur les réseaux sociaux.
Source : EFS
© iStock
Partager