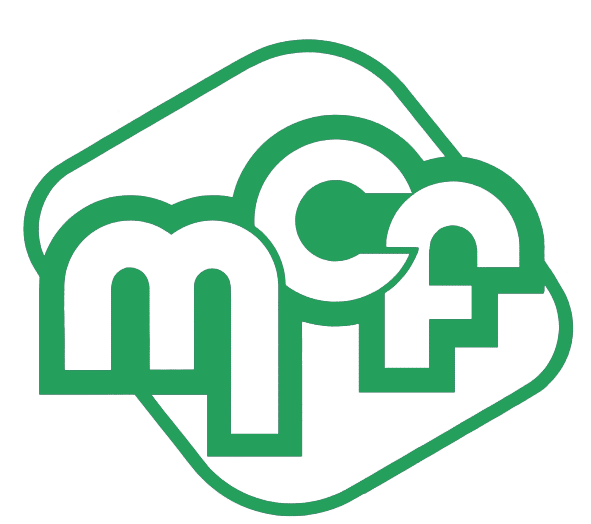Le diabète gestationnel, qu’est-ce que c’est ?

Environ 16% des femmes enceintes développent un diabète spécifique à la grossesse, qui disparaît après l’accouchement. Cette affection peut avoir des conséquences importantes sur la santé de la mère et de l’enfant à naître. Zoom sur ses risques, son diagnostic et son traitement.
Quand parle-t-on de diabète gestationnel ?
On parle de diabète gestationnel lorsqu’une femme enceinte présente une augmentation importante de sa glycémie sans que cela ne soit dû à un diabète pré-existant. Pendant la grossesse, la régulation du sucre dans le sang évolue. En début de grossesse, on peut être plus sensible à l’insuline, ce qui peut provoquer des hypoglycémies. En revanche, dans la seconde moitié de la grossesse, une résistance à l’insuline apparaît : l’élimination du sucre dans le sang est plus lente. Lorsque la glycémie dépasse un certain taux, c’est que le corps ne réagit plus assez à l’insuline ou que le pancréas en produit moins. On parle alors d’hyperglycémie.
Il existe plusieurs facteurs prédisposant à un diabète gestationnel :
- Le surpoids ou l’obésité
- La sédentarité
- Des antécédents familiaux de diabète, chez les proches parents (père, mère, frère, soeur)
- Une grossesse après 35 ans.
Cependant, un diabète gestationnel peut aussi survenir en l’absence de facteurs de risques. Sa prévalence a augmenté depuis plusieurs années : cela est dû à des facteurs de risques plus répandus mais aussi à une meilleure détection.
Newsletter
Inscrivez vous à la newsletter
Les risques et complications liés au diabète gestationnel
Le diabète gestationnel a plusieurs conséquences sur la santé de la mère, comme sur celle de l’enfant à naître. Il nécessite donc une surveillance pluri-disciplinaire jusqu’à ce qu’il soit stabilisé. Le risque le plus important est le développement d’une hypertension artérielle gravidique, qui peut évoluer en éclampsie ou un décollement du placenta. Le diabète gestationnel peut aussi provoquer de l’anxiété et récidiver lors d’une prochaine grossesse. Enfin, il augmente les risques de développer un diabète de type 2.
Lorsque le corps connaît des pics de glycémie, le sucre en excès dans le sang maternel passe dans le sang du fœtus lors des échanges placentaires. Celui-ci fabrique alors sa propre insuline et élimine les glucides superflues. Le problème, c’est que l’insuline est une hormone de croissance : si elle est produite en trop grande quantité, elle augmente le risque d’un poids de naissance supérieur à 4 kilos. Ce phénomène, nommé macrosomie, entraîne souvent un accouchement difficile et des complications. Le bébé peut aussi être touché par des hypoglycémies à la naissance. Ces complications sont heureusement rares, car le diabète gestationnel peut être équilibré et ainsi prévenir les difficultés pendant ou après l’accouchement.
Devis et adhésion en ligne
Votre devis personnalisé santé et prévoyance en moins de 3 minutes
Diagnostic, prévention et traitement du diabète gestationnel
Le diabète gestationnel n’est pas dépisté de façon systématique en France. La prescription d’un examen est laissée à l’appréciation du professionnel de santé, en fonction des facteurs de risques identifiés. Le test consiste en trois prises de sang, réalisées en parallèle de l’absorption d’un liquide très sucré, afin de contrôler la bonne élimination du sucre. Si un des chiffres est supérieur au barème, le diagnostic du diabète gestationnel est posé. Il faut alors rendre visite à un endocrinologue pour adapter ses apports en glucides et son mode de vie. Le traitement repose sur :
- La surveillance de la glycémie avant et après chaque repas
- La réduction de l’apport en glucides et le fractionnement de l’alimentation
- Le maintien d’une activité physique régulière pour aider à réguler la glycémie.
Il arrive que le régime ne suffise pas à maintenir la glycémie dans le vert. L’endocrinologue peut alors prescrire de l’insuline. Dans ce cas, la femme enceinte se verra proposer un déclenchement 2 semaines avant le terme, afin d’éviter tout risque de macrosomie. Après l’accouchement, la glycémie du nouveau-né sera contrôlée régulièrement afin de s’assurer qu’il ne présente pas d’hypoglycémie.
Lexique du diabète gestationnel
Glycémie : il s’agit du taux de sucre dans le sang. On différencie la glycémie à jeun de la glycémie post-prandiale (1h30 après un repas). La glycémie à jeun doit être inférieure à 0,95 et la post-prandiale inférieure à 1,40.
Contrôle de la glycémie : il est réalisé à l’aide d’un appareil électronique et d’une bandelette de contrôle. On pique le bout du doigt à l’aide d’un autopiqueur et on dépose une goutte de sang sur la bandelette. L’appareil donne alors le taux de glycémie. Il peut être relié à une application mobile pour transmettre les informations au médecin.
Insuline : cette hormone, naturellement produite par le pancréas, régule le taux de glucose dans le sang et le redistribue aux cellules pour apporter l’énergie à l’organisme.
Macrosomie fœtale : en France, on parle de macrosomie à partir d’un poids de naissance de 4 kg, soit dans le 97e percentile (c’est-à-dire que 97% des autres bébés naîtront avec un poids inférieur).
Alimentation fractionnée : ce mode d’alimentation repose sur la répartition des apports glucidiques en trois repas et deux collations, afin d’éviter les pics de glycémie. Cela laisse à l’organisme le temps de réguler les apports en sucres.
© iStock
Partager